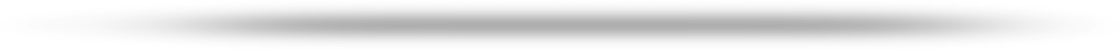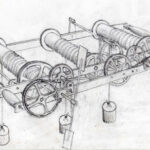Le carillon est un ensemble de cloches, permettant un jeu mélodique plus ou moins étendu et varié suivant le nombre de ses éléments (quatre notes seulement pour les carillons primitifs et même ensuite pour certains carillons célèbres comme le carillon de Westminster). La
Fédération Mondiale du Carillon a fixé à 23 le nombre minimal de cloches nécessaires pour parler de véritable carillon de concert. Selon cette même fédération, les carillons manuels comportant au moins 15 cloches sont considérés comme carillons historiques pour autant qu’ils aient été construits avant 1940.
A l’origine, qui semble remonter au haut Moyen Age en ce qui concerne l’Europe occidentale, les corps sonores étaient frappés à l’aide d’un ou de deux petits marteaux tenus à la main, comme c’est encore le cas du carillon d’orchestre. Mais, à partir du XIVe siècle et jusqu’au XVIe siècle, qui vit son apogée dans les territoires couverts actuellement par les Pays-Bas, la Belgique et le nord de la France ainsi que sa large diffusion dans les pays voisins, le carillon connut des développements considérables. Les cloches se multipliant, chacune fut pourvue d’un marteau articulé, relié par câble à l’une des touches d’un gros clavier que le carillonneur frappait du poing, tout comme aujourd’hui. Les modèles les plus importants sont aussi munis d’un pédalier.
Ainsi, l’humble sonneur finit-il par se doubler d’un virtuose, voire d’un improvisateur, à l’occasion des fêtes carillonnées ou des concerts de carillon.
D’autre part, le rôle fonctionnel du carillon en tant que complément des cloches d’église ou de beffroi entraîna l’invention de dispositifs mécaniques déclenchés par l’horloge elle-même. Le carillon put alors jouer automatiquement, à des heures déterminées, des airs préalablement « enregistrés » sur des cylindres (ou tambours) rotatifs à taquets, qui actionnaient les marteaux. Ce mécanisme était analogue à celui des boîtes à musique. Le jeu automatique était né.
Ultérieurement, on remplaça la liaison mécanique des carillons automatiques par des systèmes électriques, le tambour devenant alors un tambour à contacts électriques (il existe aussi des systèmes pneumatiques, beaucoup moins répandus).
Même si des systèmes à tambours sont encore en activité aujourd’hui, les technologies électroniques actuelles les ont généralement remplacés pour piloter les mélodies de carillon automatique. Aussi perfectionnés et ingénieux soient-ils, les systèmes automatiques ne peuvent rendre la dynamique et l’interprétation du carillonneur » (définition inspirée notamment par le Larousse de la Musique).
Envie d’en savoir plus sur les carillons ?
Visitez nos rubriques « Bibliothèque->Carillons » et « Patrimoine->Carillons ».